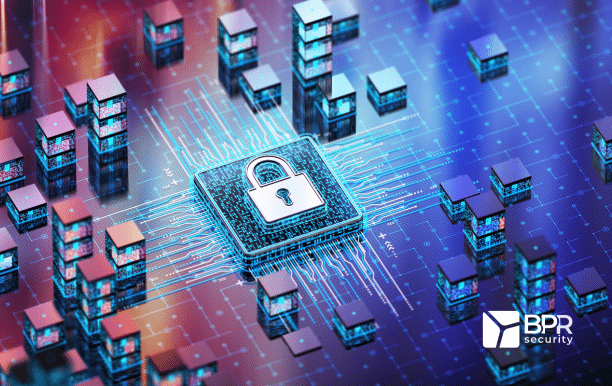Cybersécurité : dépasser le réflexe du Bac+5 pour relever les vrais défis du secteur

En France, la cybersécurité reste trop souvent perçue comme un domaine réservé aux diplômés Bac+5. Pourtant, les besoins du secteur, la diversité des métiers et l’urgence des enjeux exigent un changement de paradigme.
Une vision trop uniforme du secteur
Trop longtemps cantonnée à une spécialisation de fin de cursus en école d’ingénieur, la cybersécurité souffre encore aujourd’hui d’une image figée : celle d’un domaine technique exigeant systématiquement cinq années d’études supérieures. Cette représentation, héritée d’un temps où la cybersécurité n’était qu’une extension de l’informatique, ne colle plus à la réalité.
Et pour cause : la cybersécurité ne se résume pas à un « métier », mais à un ensemble de fonctions très variées, de la gouvernance des risques à l’analyse des menaces, en passant par la formation, l’audit ou encore la gestion de crise.
La cybersécurité, un écosystème aux profils complémentaires
Comme dans le secteur de la santé — où brancardiers, infirmiers, aides-soignants, médecins ou chirurgiens exercent des missions distinctes mais complémentaires — la cybersécurité repose sur une pluralité de métiers, chacun mobilisant des compétences spécifiques.
On distingue ainsi :
-
des profils techniques (analystes SOC, pentesters, ingénieurs systèmes, etc.) ;
-
des fonctions transverses (consultants GRC, formateurs, RSSI, etc.) ;
-
et des rôles stratégiques, requérant une vision globale et interdisciplinaire.
Tous ne nécessitent pas un Bac+5. Beaucoup de postes opérationnels ou de coordination sont tout à fait accessibles avec une formation de niveau Bac+2 à Bac+3, à condition que les compétences soient maîtrisées.
Diplômes, compétences et terrain : attention aux confusions
France Compétences, l’autorité publique en charge de la certification professionnelle, rappelle dans ses textes que :
-
le niveau 6 (Bac+3) correspond à la maîtrise d’un champ professionnel,
-
le niveau 7 (Bac+5) implique une capacité stratégique ou interdisciplinaire.
Deux confusions dominent néanmoins dans les représentations :
-
L’usage systématique du mot « expert » pour désigner un niveau Bac+5, alors que l’expertise s’acquiert avec l’expérience.
-
L’amalgame entre connaissance académique et compétence opérationnelle, qui conduit certaines entreprises à attendre d’un jeune diplômé une autonomie immédiate, sans accompagnement ni formation complémentaire.
Résultat : des jeunes brillants se retrouvent en difficulté, des recruteurs déçus, et des profils expérimentés sans diplôme se heurtent à un plafond de verre injustifié.
Repenser les recrutements pour élargir les viviers
Ce biais du Bac+5 produit plusieurs effets contre-productifs :
-
Il écarte des talents issus de formations courtes ou de reconversions ;
-
Il alimente des frustrations chez les jeunes diplômés confrontés à des attentes irréalistes ;
-
Il freine la progression de professionnels aguerris mais non diplômés.
À l’inverse, certains docteurs en cybersécurité peinent à trouver leur place sur le marché français, alors que d’autres pays leur offrent des perspectives bien plus attractives.
Le problème n’est pas l’exigence, mais la rigidité des critères.
Ouvrir le champ des possibles pour renforcer notre résilience
Pour répondre aux enjeux croissants de la cybersécurité, il devient impératif de :
-
valoriser les parcours atypiques ou non linéaires,
-
recruter sur la base des compétences réelles, et non du seul diplôme,
-
structurer des équipes pluridisciplinaires, capables d’intervenir à tous les niveaux.
Il est temps de sortir du mythe du Bac+5 comme sésame universel. Car si nous voulons véritablement bâtir une cybersécurité souveraine, accessible et opérationnelle, il faudra ouvrir grand la porte à tous les talents.
Un article réalisé par Patrice CHELIM Senior Advisor pour BPR.SECUIRTY et Vianney WATTINNE, Directeur Général de CSB.SCHOOL.
Continuez votre lecture
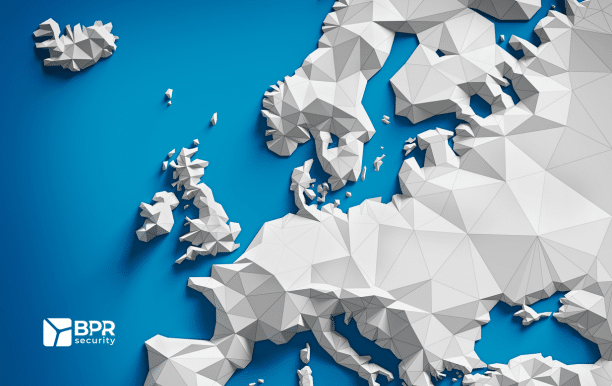
Cyber Resilience Act : vers une obligation de cybersécurité pour les produits numériques en Europe
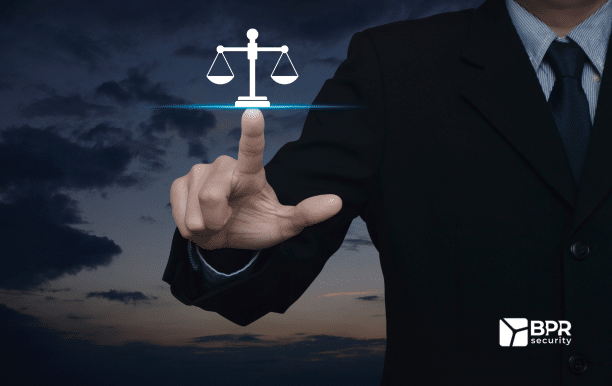
DORA : un nouveau cadre européen pour renforcer la résilience numérique du secteur financier